locus sonus > audio in art 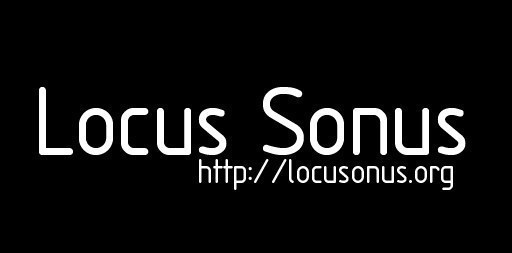
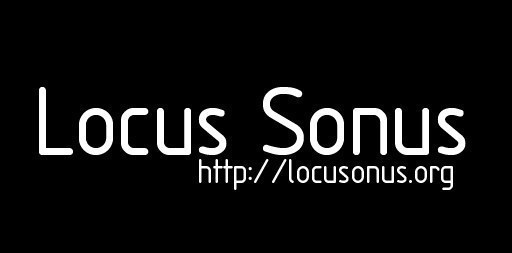
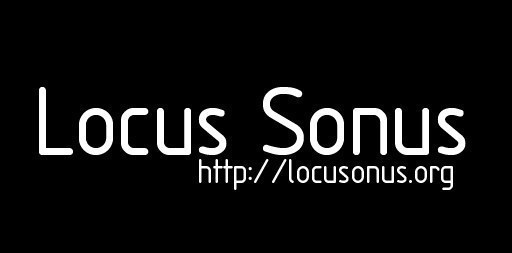
locus sonus > R&D > CNRSLast changed: 2012/03/07 17:10
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
This revision is from 2012/03/03 13:52. You can Restore it.
• 2008/2011 - contrat de recherche 1 Accord-Cadre CNRS / Ministère de la Culture (DAP-MRT) (renouvelé en 2011 pour 3 ans) • 2011/2014 - contrat de recherche 2 Accord-Cadre CNRS / Ministère de la Culture (DGCA-MRT)
LOCUS SONUS http://locusonus.org/ Post-diplôme 3ème Cycle audio in art, École Supérieure d’Art d’Aix-en- Provence, École Nationale Supérieure d’Art de Nice Villa Arson LAMES http://www.mmsh.univ-aix.fr/lames/ Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, Unité Mixte de recherche 6127, Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines MMSH, Université de Provence
Objet de la recherche 2007
audio extranautes les nouvelles perspectives de l’espace acoustique dans ses prolongements via les réseaux électroniques (TIC) Dossier de demande / Application
AUDIO EXTRANAUTES (2007-2008)
L’objet principal de notre programme Audio Extranautes investit les questionnements relatifs à l’interaction des espaces physiques et numériques (Internet, web 2.0, téléphonie, etc.) dans des dimensions sociales locales et collectives, questionnements mis en expérimentation dans les pratiques artistiques numériques sonores actuelles. Audio Extranautes, nouvelles perspectives de l’espace acoustique via les réseaux électroniques (TIC) ouvre plusieurs axes de recherche menés conjointement par les deux laboratoires:
Objet de la recherche 2008
AUDIO URBAIN ET ÉTENDU (une étude d’expérimentations artistiques basées sur l’espace sonore à multiples échelles) Dossier de demande / Application En collaboration avec : Le CRESSON Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain, Jean-Paul Thibaud (CRESSON/CNRS)
AUDIO URBAIN ET ÉTENDU (2008-2009)
L’objet de recherche du laboratoire s’ouvre sur un champ d’investigation – le field spatialization – qui déploie une réflexion et des pratiques sur des registres prenant en compte une variété d’échelles : allant du streaming à l’acoustique, la téléphonie, la radiophonie, et aux espaces virtuels. En effet l’articulation et le déplacement entre ces objets s’effectuent dans le fil des travaux menés jusqu’à présent. Les problématiques qui s’ouvrent avec cette notion de field spatialization permettent de mieux interroger et discerner les dimensions impliquées dans les pratiques sonores d’espace et en réseau. Locus Sonus s'engage dans la construction de formes artistiques (installations et performances - dans un sens large -) et de dispositifs d’interactions de ces espaces sonores. Field Spatialization : Terme que nous avons adopté qui combine la notion de field recording (enregistrement ambulatoire) (littéralement in the field : sur le terrain) avec la notion de spatialisation plus généralement liée à un dispositif fixe dans un espace intérieur. Une traduction littérale serait: spatialisation de terrain. Les systèmes développés font appel aux interactions et aux flux entre espaces virtuels et espaces physiques en tant qu’architectures/paysages à explorer et en tant que situations « jouables » et interprétables, questionnant de nombreuses dimensions que nous engageons dans la recherche et dans les expérimentations : acoustiques, distances, publics, sociales, interfaces, dispositifs, etc. Les mises en place de ces systèmes proposent des modes de collaboration et des protocoles spécifiques, correspondant à la méthodologie du laboratoire. Celle-ci s’appuie sur un investissement des technologies et des dispositifs techniques, et sur des dialogues permanents avec les laboratoires associés (LAMES, CRESSON) pour dégager ensemble les objets communs à expérimenter. En invitant le laboratoire CRESSON, Locus Sonus oriente ses axes de recherche vers des questions communes liées aux ambiances sonores : perception des ambiances, construction des ambiances, ambiances urbaines, pattern ambiant, ambiances publiques, etc. Il s'agit d'élargir la réflexion autour de l'espace sonore en comparant les recherches de Locus Sonus et ses utilisations artistiques de l'audio en espace avec celles portées par le CRESSON (et plus particulièrement avec les recherches menées par Jean-Paul Thibaud), recherches qui se concentrent davantage sur la perception et la reception des données acoustiques. Un dialogue est ainsi proposé entre l'analyse, l'observation d'un ambiance sonore et l'existence d'un œuvre dans ou relative à cet espace. Locus Sonus propose également d'introduire dans ce partenariat l'exploration des espaces sonores à différentes échelles allant du local au distant et du personnel mobile au virtuel partagé, en expérimentant différentes formes artistiques qui peuvent découler de ces télescopages. Voici quelques exemples déjà identifiés :
Il s'agit également de développer les outils techniques en adéquation avec ces projets :
Le LAMES poursuit à travers ce projet ses recherches sur les « nouvelles scénarités » entrant dans un dialogue, permanent avec les processus de création proposés par Locus Sonus. Il s'agit de porter un regard sur la manière dont les projets artistiques sont établis et constitués, ainsi que de proposer un retour permanent vis-à-vis de l'utilisation et de la fréquentation par le(s) public(s) de ces œuvres ou actions. Un autre aspect théorique propose de poursuivre la réflexion menée par Jean Cristofol sur l'importance croissante de la notion de flux dans la création contemporaine : « Flux, Stock et fuites », communication de Jean Cristofol lors du symposium Audio Extranautes, déc. 2007. Méthodologie Le programme Audio Urbain et Étendu crée une dynamique de recherche assise sur la complémentarité des trois laboratoires: le CRESSON propose une expertise analytique sur l'espace acoustique urbain - en effet le site de La Défense est particulièrement riche dans la variété et la complexité des espaces acoustiques qui sont présents -, Locus Sonus propose des pratiques artistiques découlant en partie de ces observations, et le laboratoire LAMES participe à une analyse du déroulement de ces actions et leur impact social sur le site. Le projet de recherche sur le site de La Défense peut donc être découpé en phases :
Il est prévu que ces différentes phases se complètent, s'alternent et se superposent. CRESSON (Jean-Paul Thibaud Jean-Paul Thibaud investit ses recherches sur la constitution d’une grammaire générative des ambiances urbaines : Qu'en est-il des variations et des permanences sensibles d'un espace public ? L'objectif est de rendre compte de la manière dont une ambiance urbaine s'installe en mettant l'accent sur le rôle des conduites sociales et des manières d'être ensemble. LAMES (Samuel Bordreuil, Clémentine Maillol) L’originalité de ce programme de recherche en art tient à ce que s’y mènent de concert, autour des installations de LS, explorations artistiques et investigations sociologiques. Cette collaboration fait tout d’abord fond sur le relevé de proximités dans les problématiques, aussi bien artistiques que sociologiques, qui donnent sens et enjeux aux efforts et avancées des uns et des autres. Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer deux points en particulier sur lesquels ces problématiques gagnent à dialoguer et à être mises en écho.
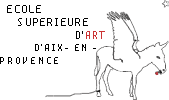







• APPELS À PROJETS DE RECHERCHE - CRÉDITS-RECHERCHE Depuis 2001 ex-DAP - DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES PÔLE RECHERCHE - DGCA - Direction générale de la création artistique MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Téléchargez le dossier Recherche publié dans la revue Culture & Recherche en 2006
Qu'est-ce que les crédits-recherche ? Les projets élus bénéficient d'un financement d'un maximum de trois années non renouvelables correspondant à une aide incitative à la création et la structuration de programmes de recherches. Le soutien correspond à un contrat de recherche qui est suivi et examiné par un conseil scientifique de la recherche et des études (DAP) Composé de personnalités appartenant aux milieux scientifique et artistique (historien d’art, critique d’art, artiste, informaticien, sociologue, enseignant en arts plastiques…), et qui est soumis à la remise de rapports intermédiaires permettant l'évaluation par ce même conseil et l'examen de la continuité du financement. La politique de recherche soutenue par la Délégation aux arts plastiques a pour finalité de :
L’objectif de cet appel à projets est :
En terme d’objectifs, la Délégation se fixe de faire paraître un appel à projets de recherche annuel et thématique afin de :
Les critères de sélection sont les suivants :
LIens : http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/recherche.html http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/rech_resultats.html http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/html/appelprojet.htm (2011) http://www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/pdf/appel-projets-recherche-2011.doc http://www.culture.fr/fr/sections/une/articles/selection-projets (2011)
|
||||
|
Lab 2013/2014: Elena Biserna, Stéphane Cousot, Laurent Di Biase, Grégoire Lauvin, Fabrice Métais, Marie Müller, (Julien Clauss, Alejandro Duque), Jérôme Joy, Anne Roquigny, Peter Sinclair. 2008/2014 — Powered by LionWiki 2.2.2 — Thanks to Adam Zivner © images Locus Sonus webmaster & webdesign : Jérôme Joy contact: info (at) locusonus.org 2004-2014 Locus Sonus |
||||
Article:
Admin functions:
Other:
Search:
Language:
Info:
Powered by LionWiki 2.2.2
Tested on FireFox2, FireFox3, Safari2, Safari3