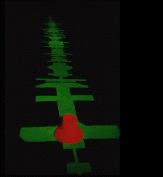LOCUS SONUS
Orientations
Première Rubrique :
• Audio & Espaces
mot-clés: installation, déambulation, espace architectural, espace virtuel, espace public, interactivité, narration, réalité augmentée, ...
Dans le champ des pratiques audio, la notion d'espace a permis de problématiser les pratiques d'installation sous des formes modulaires et interactives dont une des références principales et historiques reste Rain Forest de David Tudor [1]. La mise en espace et l'espace pris comme paradigme plastique "augmenté" par le son ont permis de redéfinir l'écoute du spectateur à mi-chemin entre l'exposition et le spectacle, et entre la sculpture/installation et le dispositif. Les objets articulés dans ces pratiques de l'espace prennent naissance dans un développement en mutation permanente de l'espace architectural/sonore, alimenté par les ressources issues de l'interactivité et de la spatialisation.
Bien que ce champ soit vaste et ouvert à de multiples perspectives, on peut identifier un certain nombre de pistes déjà empruntées et les faire converger vers une réflexion qui nous intéressent plus particulièrement: l'espace problématisé par le son; que cet espace soit celui de la représentation, des dimensions sonores, de l'architecture, de l'espace social, etc. Ces références peuvent nous aider à mieux identifier l'envergure des expérimentations à mener et à vectoriser, à l'aide de repères, les différentes phases d'élaboration et de réalisation.

Suivons le cours du temps:
Un art sonore qui trouve ses origines dans la sculpture et l'indexation sur la musique avec les bruiteurs du futuriste Luigi Russolo, les instruments de musique à caractère monumental de Harry Partch ou encore "Music Store" de Joe Jones. Puis se développent les articulations de l'espace et de l'interactivité dans l'installation sonore avec l'oeuvre emblématique de David Tudor, "Rain Forest": une multitude d'objets tous différents et improbables sont suspendus au plafond à hauteur d'oreille. L'espace est rempli de doux sons émis par ces objets qui sont mis en résonance par des transducteurs.
En 1968, John Cage et Marcel Duchamp jouent aux échecs sur un échiquier électroniquement modifié par Lowell Cross pour produire des sons en fonction des déplacements des pieces. Gordon Mumma, David Tudor et David Behrman gèrent la diffusion. Les paramètres de l'espace deviennent contrôlables et révélés par le son, le dispositif de recouvrement devient ludique, générateur et collectif.
 
Un peu plus tard, les installations de La Monte Young éliminent la présence de l'objet matériel pour proposer une espace immersif transparent et résonnant aux harmonies d'un gamme inventée par l'artiste [2]. Aujourd'hui, Granular Synthesis explore un espace sonore en perpétuelle évolution en exploitant les techniques de la synthèse granulaire (comme leur nom l'indique): des micro-boucles d'images video superposées en couches et spatialisées avec l'aide d'une sonorisation surpuissante et enveloppante [3].
L'espace devient "sans mur": des environnements sonores dans lesquels la déambulation fait office de principe pour découvrir l'oeuvre, (ou aussi des environnements dans lesquels il faut plonger: Max Neuhaus [4] et plus tard Michel Redolfi; ou qui font résonner l'espace architectural naturel ou urbain: Bill Fontana [5], Erik Samakh [6], Richard Lerman [7]).
Jusqu'aux plus récentes investigations permettant à l’espace sonore d'évoluer, de réagir, d'être remis à jour (updaté), de devenir réticulaire, d'être relié aux réseaux et à l'internet: Steim [8], David Rokeby [9], Atau Tanaka et Kasper T. Toeplitz [10], les projets de streaming, etc.
D'autre part, l'audio-visuel - ou ne pourrait-on pas parler plutôt de visio-audio - investit l'espace de vision "mené" par un travail sonore: "La Jetée" de Chris Marker, "Head Candy " de Brian Eno, "No sex last night" de Sophie Calle, ou encore "Timecode" de Mike Figgis ou "Dubbing" de Pierre Huyghe.
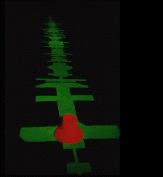 
On peut aujourd'hui identifier un historique de la spatialisation sonore qui trouve ses débuts dans des travaux expérimentaux orchestraux de compositeurs (de Tallis, Gabrieli à Xenakis et à Stockhausen) et qui se développe au cours des années 70/80 dans le domaine de la musique electroacoustique (acousmonium).
Les technologies se développant et se démocratisant, l'accès aux cartes audio-numériques multicanaux sur nos ordinateurs actuels nous permet d'augmenter la représentation stéréo, de la multiplier point par point et de jouer du déplacement du son en automatisant la diffusion audio à multiples sources (spatialisation et programmation [11]). L'espace éclate, est décomposé pour être reconstruit, virtualisé. Ceci implique que la diffusion peut être rendue indépendante de la présence de l'artiste, mais également qu'une multitude de processus de captation et d'organisation des sons peut être employée: conceptuels, géométriques, interactifs, etc. La liste dépasse le champ traditionnellement associé à la diffusion musicale et ouvre des articulations essentielles vers des domaines de ressources (robotique, télématique, etc.).
----------------------------------
[1] http://www.emf.org/tudor/
[2] http://melafoundation.org/
[3] http://www.granularsynthesis.info/
[4] Water Whistle 1971 , http://www.emf.org/subscribers/neuhaus/listofworks.html
[5] http://www.resoundings.org/
[6] http://eriksamakh.free.fr/
[7] http://www.west.asu.edu/rlerman/
[8] http://www.steim.nl/
[9] http://homepage.mac.com/davidrokeby/home.html
[10] http://www.sensorband.com/atau/
[11] Nos étudiants présentent depuis plusieurs années des travaux basés sur la spatialisation audio et qui utilisent des logiciels developpés par le GMEM et L'IRCAM.
|
|